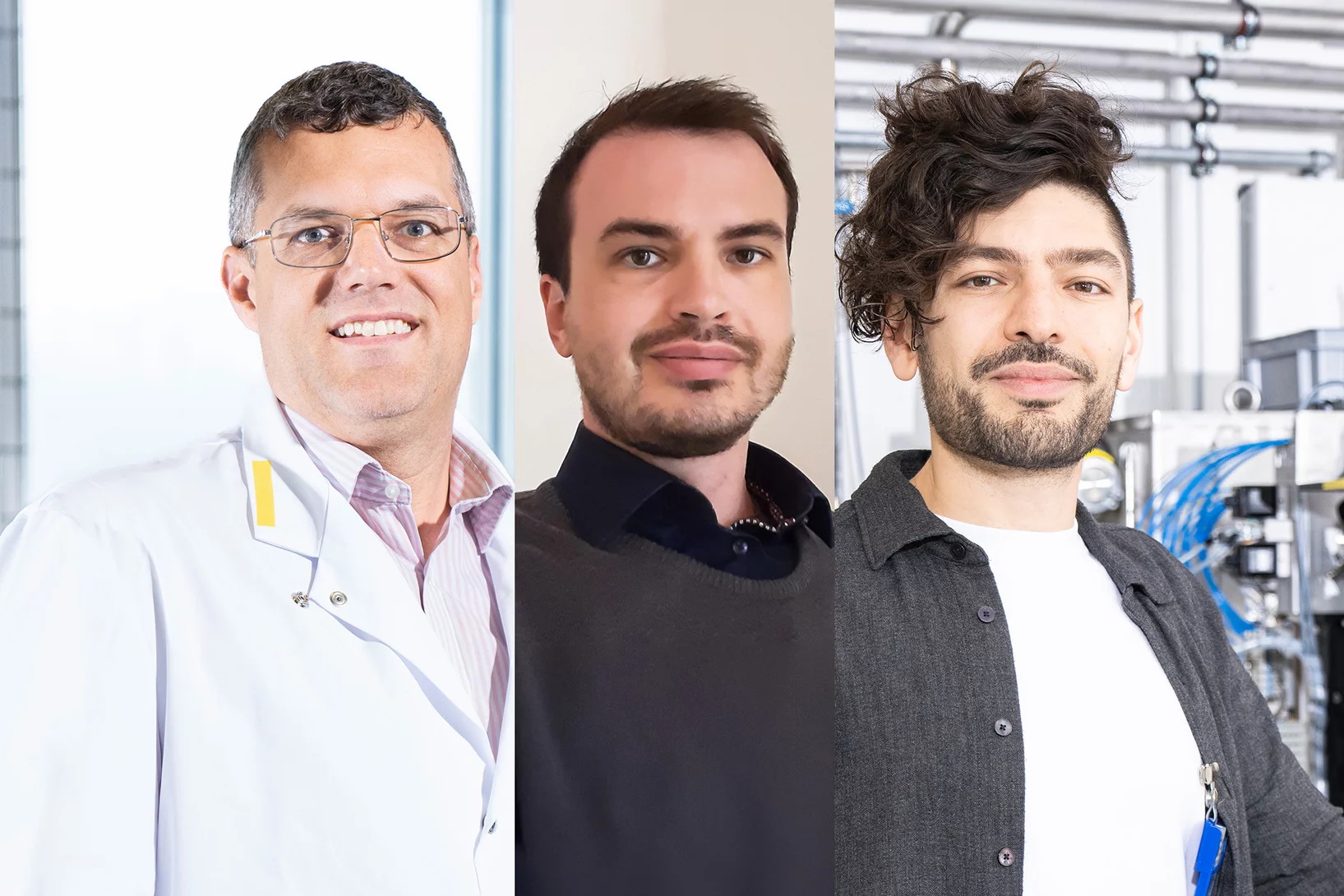«Regarder le béton durcir est beaucoup plus passionnant qu’on ne l’imagine»
Gris, dur, pas vraiment intéressant: pour la plupart des gens, ces trois qualificatifs fournissent une description qui fait le tour du matériau qu’on appelle béton. John Provis ne voit pas les choses de cette manière. Ce scientifique à l’Institut Paul Scherrer PSI a consacré sa vie de chercheur à ce matériau de construction omniprésent et qui joue un rôle économique important. Son objectif: percer les mystères du béton.

Le béton, dont sont constitués de nombreux ponts en Suisse, est le domaine de spécialité de John Provis, chercheur en sciences des matériaux. A l’Institut Paul Scherrer PSI, il étudie ce matériau de construction largement répandu afin de l’améliorer et de le rendre plus durable. © Institut Paul Scherrer PSI/Mahir Dzambegovic
Pour un chercheur spécialiste du béton, la Suisse est l’endroit idéal, affirme John Provis. Ce chercheur de 45 ans a grandi à Melbourne, en Australie, et travaille depuis 2023 à l’Institut Paul Scherrer PSI. «La Suisse n’a pas seulement une position internationale de leader dans la recherche sur le ciment, poursuit-il. Elle est également connue pour utiliser beaucoup de béton de haute qualité dans la construction. Il suffit de regarder les bâtiments qui nous environnent pour s’en rendre compte.»
Au PSI, John Provis sonde ce matériau de construction à de nombreuses échelles différentes: «Il m’arrive d’examiner un petit échantillon de béton de 10 micromètres et la semaine suivante un bloc de béton de 3 mètres de côté», raconte-t-il. Il assemble ensuite les différentes pièces du puzzle, c’est-à-dire les résultats livrés par ses expériences dans le but de mieux comprendre ce matériau, et ce de fond en comble.
Interaction au niveau des couches limites
«Je regarde littéralement le béton en train de durcir», explique John Provis, en allusion malicieuse à l’idée que l’on se fait de cette activité: l’ennui complet. Car à ses yeux, c’est une activité extrêmement intéressante.
Le béton est obtenu en mélangeant du ciment en poudre, des granulats – comme du sable, du gravier ou des gravillons – et de l’eau avec des additifs tels que des poudres minérales, des cendres et des polymères spéciaux. Lorsqu’il durcit, on obtient un matériau semblable à la pierre, très apprécié par l’industrie du bâtiment. En Suisse, chaque année, quelque 17 millions de mètres cube de béton sont ainsi utilisés dans la construction, ce qui en fait le matériau de construction le plus employé dans le pays.
John Provis s’intéresse surtout à la manière dont se passe la rencontre entre l’eau et les différents grains de ciment, de roche et de cendre. Ce sont des composants de tailles très différentes et leur interaction complexe est encore loin d’être comprise. Pour l’étudier, John Provis s’est vu allouer récemment un prestigieux Advanced Grant de plus de 2,14 millions de francs suisses pour cinq ans par le Fonds National Suisse (FNS).
Microscopie, techniques aux rayons X, spectroscopie, rayonnement neutronique et synchrotron: John Provis utilise de nombreuses technologies différentes pour scruter le béton. Avec l’offre que le PSI réunit en matière de grandes installations de recherche, il est bien entouré.
«Faire de grandes choses avec de la chimie»
Les étagères du bureau de John Provis sont bourrées d’innombrables livres et revues spécialises consacrés au béton et au ciment. Entre deux, le chercheur conserve des exemplaires de matériaux qu’il juge particulièrement intéressants en forme de cubes ou de blocs de la taille de la main.
John Provis a étudié l’ingénierie chimique et c’est par hasard qu’il s’est retrouvé dans la recherche sur le béton et le ciment: «J’ai toujours voulu faire de grandes choses avec de la chimie», raconte-t-il. Au départ, c’était la pétrochimie qui se profilait à ses yeux comme la meilleure option. Mais lorsqu’il a cherché un poste d’assistant de recherche à court terme pour ses vacances universitaires à Melbourne, il s’est retrouvé dans un groupe qui étudiait le ciment comme barrière contre les substances nocives pour l’environnement. Il a ensuite consacré sa thèse de doctorat à la recherche sur le ciment, rejoignant ainsi un secteur qui compte parmi les plus importantes branches industrielles du monde. Là, sans aucun doute, Il est en mesure de «faire de grandes choses avec de la chimie».
De l’Australie à l’Europe
En 2012, après son doctorat et son post-doctorat, John Provis a quitté l’Australie pour l’Angleterre avec sa femme, qui est elle aussi professeure en matériaux de construction durables. A son poste de professeur à l’Université de Sheffield, il a travaillé entre autres à l’élaboration de béton durable. Car la fabrication de ciment est l’une des grandes responsables des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. «Tout ce que nous pouvons faire pour réduire la part de ciment dans le béton est une bonne chose», souligne-t-il.
Il aime emmener ses étudiants lors de visites guidées informelles dans des villes et des universités, au cours desquelles il leur montre les différentes manières dont le béton peut présenter des défaillances. «Du genre: ici, il y a un bout d’acier qui dépasse parce que le béton n’était pas assez épais et, maintenant, l’acier rouille, raconte-t-il. Ou encore: là, le béton s’émiette en surface, probablement à cause de l’eau qui gèle.»
Bien arrivé en Suisse
John Provis adore étudier ce matériau si complexe et pourtant si quotidien. «Dans le fond, le béton est un matériau très performant, mais la plupart des gens qui travaillent avec ne sont pas des ingénieurs du béton hyperspécialisés, relève-t-il. Nombreux sont ceux qui fabriquent leurs béton avec une brouette, une pelle et un tuyau d’arrosage pour ancrer un piquet de clôture dans leur jardin.» Et la plupart du temps, ça marche plutôt bien. «Le béton pardonne beaucoup, explique-t-il. Même s’il est mal mélangé, on obtient un matériau qui peut être utilisé sans problème.»
Cela fait deux ans tout juste que John Provis est chercheur au PSI. Le ciment, explique-t-il, n’est pas juste un ingrédient du béton. Il est utilisé également pour enfermer les déchets radioactifs de manière sûre et les conserver. Avec son équipe, il est donc rattaché au Centre de l’ingénierie et des sciences nucléaires du PSI.
En Suisse, John Provis se sent bien. Il raconte presque avec respect que dans son lieu de résidence, à Würenlos, se trouve un abreuvoir pour chevaux, absolument pas spectaculaire, qui date des années 1740. « C’était encore avant l’arrivée des premiers colons européens en Australie!», s’exclame-t-il. Il aime également explorer les pays voisins: «L’Europe abrite une telle richesse culturelle avec son histoire, ses traditions et sa diversité linguistique, dit-il. Je savoure énormément d’en faire partie et d’apprendre à la connaître.»
John Provis accepte également volontiers qu’en Suisse, il ne peut pas proposer à ses étudiants des excursions pour leur montrer du béton de mauvaise qualité.
- Les Romains ont été parmi les premiers de l’histoire à bâtir en utilisant du béton. La coupole du Panthéon à Rome est, aujourd’hui encore, la plus grande structure de ce genre à avoir jamais été construite sans renfort en acier. Vers 30 avant J.-C., Marcus Vitruvius Pollio, ou Vitruve, a écrit Les Dix Livres d’architecture où il décrit la formule du béton telle qu’elle était utilisée dans l’Empire romain.
- La fabrication du ciment est nocive pour le climat: les six cimenteries de Suisse sont responsables d’environ 5 pour cent des émissions nationales de gaz à effet de serre. Pour fabriquer du ciment, on chauffe du calcaire à environ 1400 degrés Celsius, ce qui dégage du dioxyde de carbone. Par ailleurs, la procédure est très énergivore.
- Lors du malaxage du béton, le mélange se fait plus facilement si l’on ajoute davantage d’eau. Mais s’il y en a trop, la pâte de ciment et les gros granulats risquent de se séparer avant que le béton ne durcisse. De grosses pierres peuvent tomber au sol, par exemple, produisant ainsi des «nids de gravier» et donc un béton de mauvaise qualité.
- Lorsqu’on coule du béton, on utilise souvent des moules en bois ou en acier. Une fois qu’il a durci, le béton obtenu présente l’impression du moule, par exemple le veinage du bois dont le moule était fait.
- Contrairement à l’asphalte, le béton durcit plus vite lorsqu’il fait chaud. Cela peut devenir un problème lorsqu’un camion toupie qui transporte du béton encore liquide est bloqué dans le trafic par temps chaud. Un sac de sucre peut résoudre le problème: versé dans le béton liquide, il empoisonne la réaction chimique et empêche le béton de durcir. Le béton doit ensuite être jeté, mais le camion toupie, lui, est sauvé.
Contact
Dr John Provis
PSI Center for Nuclear Engineering and Sciences
Institut Paul Scherrer PSI
+41 56 310 41 35
john.provis@psi.ch
[anglais]