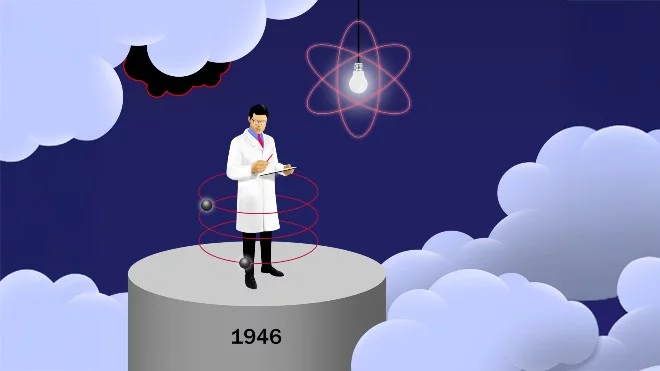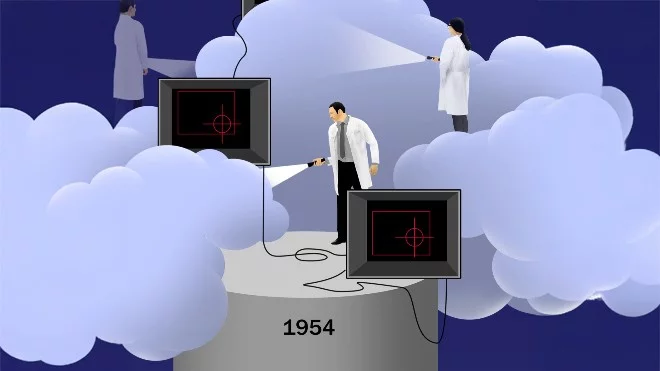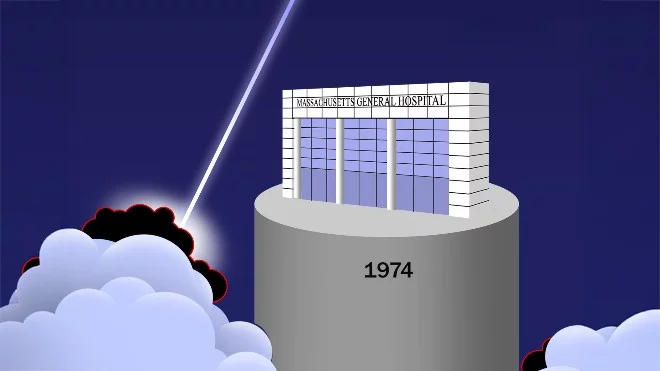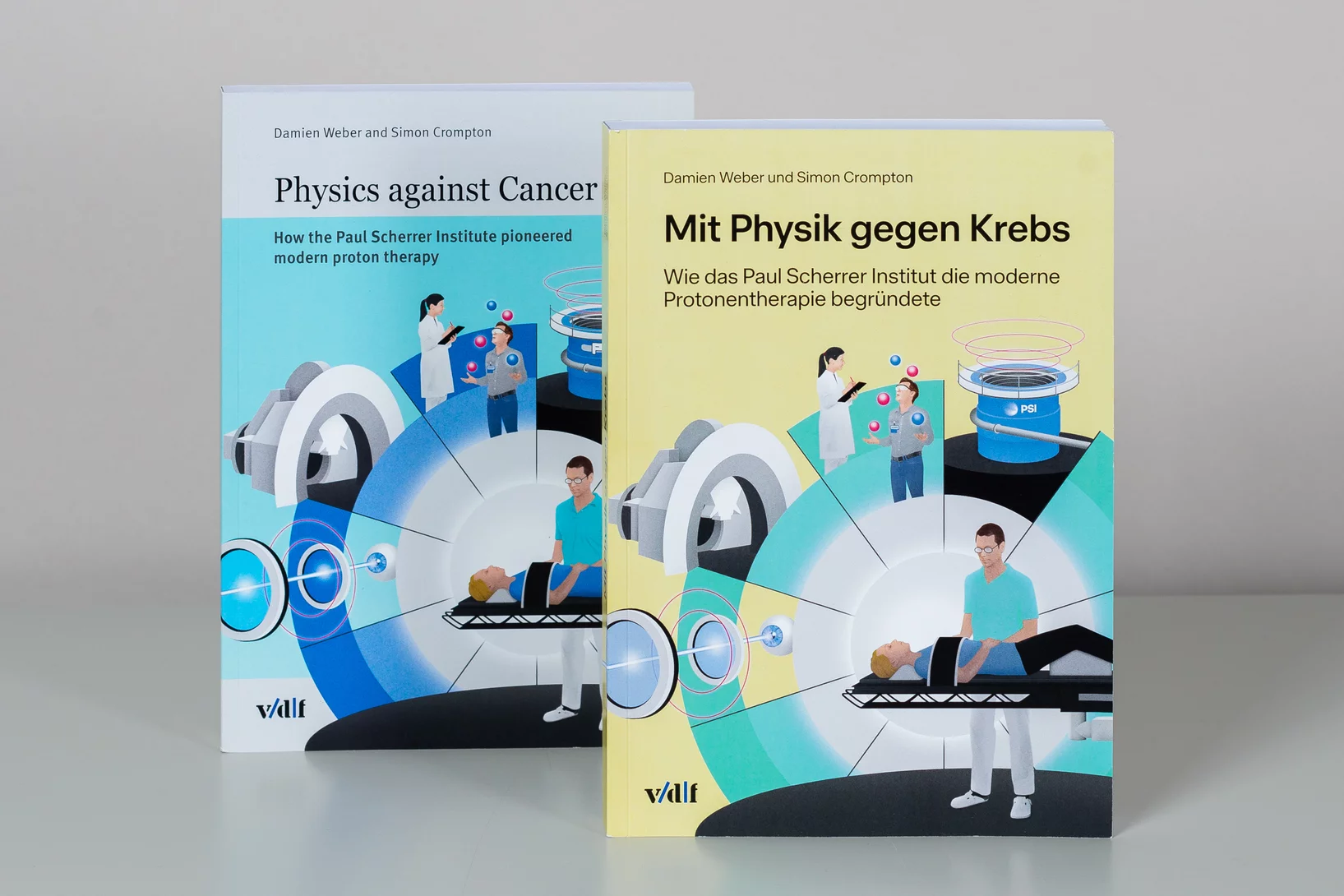De la haute technologie pour lutter contre le cancer
Au Centre de protonthérapie du PSI, des patientes et des patients sont traités avec efficacité et ménagement à l’aide d’une méthode mise au point au PSI : la protonthérapie utilise l’énergie des protons pour détruire les cellules cancéreuses.
Qu’est-ce que les protons?
Les protons sont des éléments constitutifs des atomes. Toute la matière qui nous entoure est composée d’atomes. Les noyaux de ces derniers sont constitués d’un nombre différent de protons chargés positivement et de neutrons électriquement neutres. Le noyau atomique est entouré d’une couche électronique faite d’électrons chargés négativement. Comme toutes les particules chargées, les protons peuvent être déviés par des champs magnétiques, et ainsi être groupés et concentrés pour former un faisceau.
Un bref voyage dans le temps :
Entre la première idée et sa pratique actuelle, plus de 70 ans se sont écoulés. Des dizaines d’années de recherches et des développements technologiques sophistiqués ont fait du Centre de protonthérapie (CPT) du PSI l’un des principaux centres de traitement et de recherche au monde pour le traitement ciblé de tumeurs par des protons.
1946
L’Américain Robert R. Wilson est bouleversé par l’impact de la bombe atomique. Ayant participé à son développement, il se met à prôner un usage pacifique de l’énergie nucléaire. Il est le premier scientifique à proposer d’utiliser des particules chargées, notamment des protons, pour traiter le cancer.
Pic de Bragg
La proposition de Wilson est basée sur les conclusions que William Henry Bragg avait tirées environ 40 ans auparavant. Bragg avait prouvé que lorsqu’ils traversent la matière, les protons libèrent leur énergie maximale juste avant de s’immobiliser. Autrement dit, à la différence des photons et donc des rayons X, ils peuvent déposer leur plus forte dose de rayonnement directement dans la tumeur. Ainsi, ils affectent dans une moindre mesure les tissus sains qui se trouvent devant la tumeur et pas du tout ceux qui se trouvent derrière.
1954
Quelques années plus tard, les premières études cliniques portant sur l’application thérapeutique du rayonnement de particules démarrent aux Etats-Unis. Les premières tumeurs que l’on traite alors sont des tumeurs neuroendocrines de l’hypophyse, car l’imagerie diagnostique n’en est qu’à ses débuts et les méthodes de l’époque ne permettent pas de localiser d’autres tumeurs avec suffisamment de précision.
Années 1970
L’évolution de l’imagerie diagnostique, comme l’avènement de la tomodensitométrie ainsi que les progrès de la radiothérapie assistée par ordinateur rendent possible le traitement de tumeurs malignes par irradiation de particules.
1974
En 1974, le premier patient atteint d’une tumeur maligne est traité par protonthérapie au Massachusetts General Hospital (Boston, Etats-Unis).
1980
Un accélérateur de protons au PSI, déjà en service depuis 1974, permet à une équipe de médecins, de physiciens et de techniciens engagés de mettre au point une méthode précise de traitement des tumeurs par protons.
Instituts de recherche
En règle générale, les centres de protonthérapies sont issus d’instituts de la recherche. Car pour mettre en œuvre une méthode aussi complexe, il faut des connaissances et de l’expérience qui résultent de la recherche fondamentale, mais aussi une infrastructure de recherche en conséquence, comme celle dont disposent le PSI et des centres de recherche comparables.
1984
La protonthérapie est utilisée depuis 1984 au PSI pour traiter des patientes et des patients atteints d’une tumeur oculaire. L’installation de traitement OPTIS est disponible à cet effet.
1996
La Gantry 1 est mise en service au PSI. Elle est la première installation au monde où des patients sont traités dans le cadre d’un traitement clinique de routine avec la méthode Spot Scan, mise au point au PSI. Avec cette technologie thérapeutique, le faisceau de protons peut être contrôlé pour que le point (spot) où les protons déposent leur plus forte dose d’énergie soit localisé juste à l’endroit souhaité dans la tumeur. La superposition de nombreux spots individuels permet de couvrir uniformément la tumeur avec la dose de rayonnement requise, et donc une irradiation homogène et extrêmement précise, adaptée de manière optimale à la forme généralement irrégulière de la tumeur. La technique Spot Scan est aussi appelée pencil beam scanning ou balayage à faisceau-crayon, car le faisceau est à peu près aussi fin qu’un crayon.
1998
Le succès du traitement oculaire et l’intérêt international que suscite la technique Spot Scan poussent le PSI à élaborer des stratégies pour continuer à faire évoluer la protonthérapie. La décision est prise d’intensifier la recherche et le développement, ainsi que d’élargir les possibilités de traitement de patients par protonthérapie au PSI.
2007
La protonthérapie au PSI a désormais son propre accélérateur en forme d’anneau. Jusque-là, les protons étaient générés par le grand accélérateur de protons du PSI. Ce dernier servant principalement des objectifs de recherche, il est en révision pendant plusieurs semaines chaque année. Le nouvel accélérateur compact et supraconducteur permet de traiter des patients durant toute l’année.
2013
Le perfectionnement de la première Gantry permet l’avènement d’un nouvel appareil d’irradiation, la Gantry 2, équipée de davantage d’options d’irradiation. Le premier patient est irradié à la Gantry 2 en novembre 2013.
2018
La Gantry 3, une autre installation de traitement ultra-moderne, est mise en service. Elle a été réalisée dans le cadre d’une coopération de recherche avec un prestataire commercial. Sur le plan technique, la Gantry 3 offre des possibilités de traitement comparables à la Gantry 2.
Fin 2018, le traitement des patients à la Gantry 1 cesse. Plus de 1300 patientes et patients y ont été traités avec succès. La Gantry 1 continue d’être utilisée à des fins de recherche.
Fonctionnement de la Gantry
Les stations de traitement du Centre de protonthérapie au PSI permettent d’irradier des tumeurs dans toutes les directions. La tête d’irradiation de la Gantry peut pivoter à cet effet autour du patient. Une Gantry pèse plus de 200 tonnes; une multitude d’aimants dirigent précisément le faisceau de protons au bon endroit.
Accélération de protons
Les protons proviennent de la source d’ions qui se trouve dans l’accélérateur en forme d’anneau. Là, des atomes d’hydrogène sont décomposés de manière continue en électrons et en protons. Une fois qu’ils ont fait 630 fois le tour de l’accélérateur, les protons sont dirigés vers la trajectoire du faisceau où ils sont groupés et concentrés à l’aide d’aimants. Ils filent alors à deux tiers de la vitesse la lumière sur les quelque 50 mètres du trajet de faisceau jusqu’à l’une des stations de traitements où ils sont braqués de manière ciblée sur la tumeur.
Aujourd’hui
La technique Spot Scan mise au point par le PSI s’est imposée dans le monde entier en tant que technologie de référence dans le domaine de la protonthérapie. Elle fait sans cesse l’objet de perfectionnements au PSI. L’objectif est d’augmenter la rapidité du traitement, mais aussi d’améliorer encore la précision. Le PSI se distingue d’un hôpital ou d’un fabricant industriel par le lien étroit entre développement technique et exploitation clinique. Sur le plan clinique, le PSI participe à des études internationales. L’objectif est d’élargir le spectre thérapeutique afin que des patients cancéreux, dont les indications ne sont pas encore autorisées en Suisse, puissent également bénéficier des avantages de la protonthérapie.
Dans le monde, le nombre de centres équipés pour la protonthérapie Spot Scan ne cesse de croître. En 2020, on en dénombrait 90 et ce chiffre pourrait bien doubler d’ici 2030. Les patients dans le monde entier seront ainsi toujours plus nombreux à bénéficier de cette